Retrouvez le dossier complet
À la recherche d’un nouvel équilibre
Adopté à marche forcée pendant la crise sanitaire, le télétravail dans la fonction publique est possible et constitue même un argument de recrutement. Toutefois, les employeurs restent frileux quant au nombre de jours accordés, malgré un cadre législatif généreux.
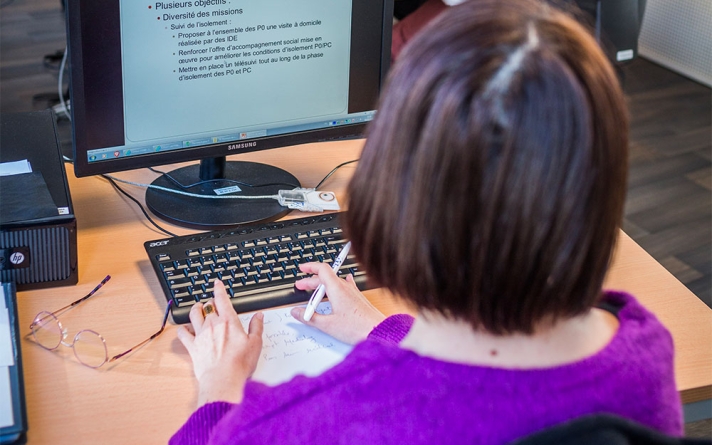
Depuis l’accord-cadre du 13 juillet 2021, les agents publics des trois versants (État, hospitalière et territoriale) peuvent télétravailler jusqu’à trois jours par semaine, selon les missions exercées et les besoins du service. Comme pour les salariés du privé, l’accord garantit le volontariat, la réversibilité du dispositif et l’égalité d’accès, tout en prévoyant un accompagnement des encadrants à la gestion du travail à distance. Pourtant, dans la pratique, sa mise en place n’est pas une évidence.
« Malgré les textes, les employeurs publics restent très réticents à accorder du télétravail », confie Carole Chapelle, secrétaire générale adjointe de la CFDT Fonctions publiques. Sans compter que seuls trois agents sur dix indiquent occuper un emploi compatible avec le télétravail (et parmi eux 54 % y ont recours). (Voir l’étude « Un agent de la fonction pubique sur six déclare télétravailler en 2023)»). « Pourtant, l’accord de 2021 prévoit que l’éligibilité à ce mode d’organisation du travail se fasse en partant des activités plutôt que des emplois, de façon à permettre à tous les agents de pouvoir télétravailler les tâches qui peuvent l’être. Mais cette réflexion n’a pas eu lieu, probablement pour sa difficulté à être menée. »
Une tendance que confirme l’étude* de la DGAFP. Parmi les agents qui télétravaillent, seulement 11 % le font au moins trois jours ou plus par semaine, contre 40 % en 2021. Dans le privé, cette part est de 24 %. De plus, les agents sont 61 % à ne pas effectuer plus d’un jour de télétravail par semaine, contre 41 % dans le secteur privé. Ainsi, si ce mode d’organisation du travail semble désormais être bien ancré dans ce secteur – « la plupart des offres d’emploi mentionnent si le poste à pourvoir est télétravaillable ou pas », précise Carole Chapelle –, il semblerait que les employeurs publics fassent preuve de plus de prudence que leurs homologues du privé quant au nombre de jours accordés…
Bien s’organiser, un enjeu d’équité
À Montpellier méditerranée métropole, la mise en place du télétravail sans concertation avec les organisations syndicales fait partie des sujets qui fâchent. La CFDT déplore, notamment, l’absence de formation sérieuse des managers.
Dans cette collectivité de 31 communes et 8 000 agents, le télétravail reste un sujet clivant. « L’accès inégal au télétravail est source de discrimination au sein des services », estime Patrice Lorthiois, secrétaire de la section à la métropole. En cause notamment, un déploiement du télétravail laissé à l’initiative des directeurs de service et qui ne s’appuie pas sur des tâches objectivement télétravaillables, mettant de facto à l’écart un certain nombre d’agents qui pourraient y être éligibles.
« Après cinq ans, l’administration n’avait réalisé aucun bilan. Nous avons alors lancé une enquête l’année dernière pour appuyer nos revendications, car les agents, eux, sont demandeurs », poursuit le militant.
En plus d’une étude fine des activités télétravaillables, la CFDT souhaite faire évoluer la règle de deux jours de télétravail pour tous, qui est loin d’être respectée. « Il y a un enjeu d’équité mais aussi de confiance. Nos managers ne sont pas prêts, ils n’ont reçu aucune formation au travail à distance, chacun fait comme il peut et une majorité d’entre eux continuent de gérer le télétravail comme du présentiel. »
Cela se traduit par la volonté d’assigner à résidence les télétravailleurs en rejetant la possibilité pour eux d’aller travailler dans des tiers-lieux, le refus d’accorder du télétravail aux personnes à temps partiel – « trop compliqué, dit l’employeur » – ou encore le refus d’indemniser les jours de télétravail, la prise en charge des frais inhérents à cette organisation étant sans doute jugée trop incitative, à l’encontre de la volonté de l’administration.