Les startups d’État ont vocation à améliorer la qualité de vie au travail des agents et renforcer la proximité avec les usagers. Elles sollicitent les compétences des fonctionnaires et contractuels. Une petite révolution au sein de la fonction publique, peu habituée à donner la parole à ses agents.
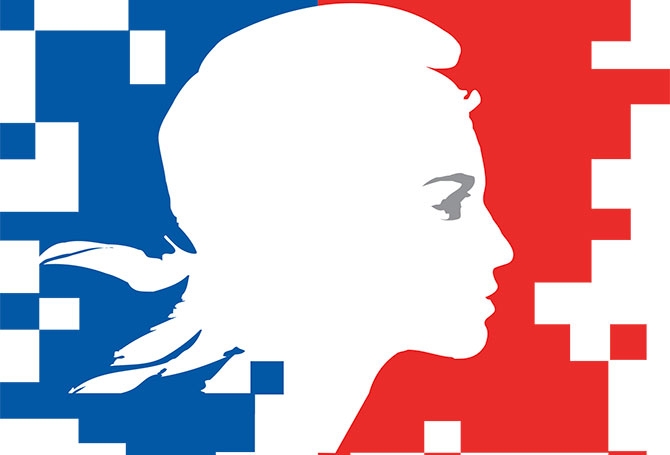
« Créer le service public numérique de demain. » Voilà l’ambition de Léry Jicquel, adhérent CFDT, fonctionnaire de la Cour des comptes et startuper d’État. Le jeune homme est « intrapreneur », agent détaché de son administration, il met ses compétences au service de son institution pour développer un projet utile à celle-ci.
Comme lui, 250 personnes, agents publics détachés de leur administration et prestataires privés, travaillent à la transformation numérique de la vie publique française. « Notre objectif est d’améliorer le service public de l’intérieur grâce à l’expérience et à l’expertise de ses agents », résume Hela Ghariani, responsable de l’incubateur des services numériques à la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (Dinsic). À ce jour, 92 startups ont été créées.
Si les projets sont divers – inscrire son enfant au collège, aider au développement du transport fluvial, augmenter le nombre d’actions artistiques et culturelles dans les établissements scolaires, etc. –, la motivation des agents, elle, est identique : « On est tous venus ici avec une forme de colère, en se disant que le service public pourrait être plus efficace si on faisait différemment. » La startupeuse estime qu’il n’y a rien de pire que de laisser un problème et la frustration s’installer : « Cela détériore les relations et les conditions de travail. Ça crée un malaise. »
La Dinsic, placée sous l’autorité du Premier ministre, a pour mission d’améliorer l’action numérique des administrations. Comment ? en faisant appel aux compétences de celles et ceux qui le vivent au quotidien : ses agents. Elle leur demande de témoigner des difficultés de leurs missions et les invite à proposer des solutions afin de les résoudre. « On reçoit des dizaines, des centaines de signalements et autant de propositions d’améliorations ! », témoigne Hela.
Si certains collègues montrent de l’intérêt, la défiance des autres doit être prise en considération. Les raisons de douter sont multiples. « Le numérique est d’abord perçu comme un outil conçu pour faire des économies, explique Hela. Mais ce n’est pas tout. Ces dernières années, on a construit des programmes informatiques qui ont coûté cher, pas toujours adaptés aux besoins des usagers et qui n’évoluaient pas en fonction des réalités. » Le temps de l’explication et de la pédagogie est donc essentiel. « Il s’agit bien de faire avec les agents et pour les agents », insiste Léry Jicquel. « Nous sommes là pour faciliter leur quotidien et améliorer leur qualité de vie au travail. »
Se réapproprier l’action
« De toute façon, les meilleures idées, ce sont les agents qui les ont ! », rappelle Léry. Un exemple ? « La bonne boîte », un dispositif mis en place à Pôle emploi. Un agent de Hayange, découragé et fatigué d’annoncer aux demandeurs d’emploi qu’il n’avait pas d’offres à leur proposer, a étudié le marché caché de l’emploi (des emplois pour lesquels aucune offre n’a été publiée). « Concrètement, il avait accès au…